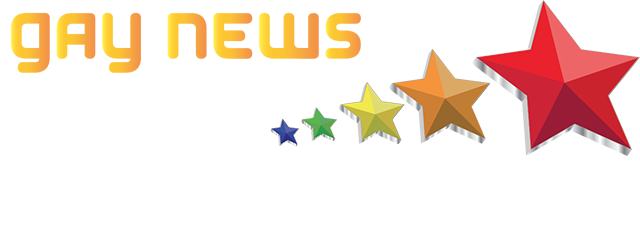
Blog for the LGBT community, informative and amusing – A new vision for the world
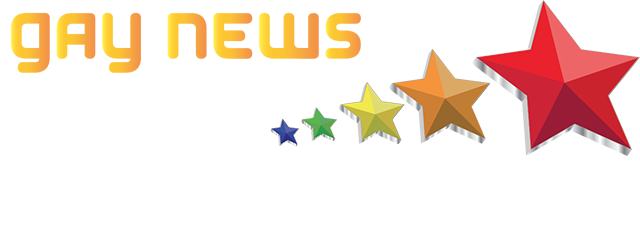
Blog for the LGBT community, informative and amusing – A new vision for the world

(Blogmensgo, 10 mai 2011) Marguerite Yourcenar dit, dans quelqu’une de ses préfaces, que le lecteur d’une époque connaît souvent moins la production de ses contemporains que celle de ses aînés d’une ou deux générations, écrivains d’hier devenus classiques d’aujourd’hui. Ainsi ai-je lu Gide avant même de connaître les noms de Guibert, Koltès ou Hocquenghem. De même n’ai-je lu – ou commencé à lire – la prose militante ou didactique de Gide qu’après avoir lu la quasi-totalité de son œuvre à vocation strictement littéraire.
C’est ce deuxième cas de figure qui me fait découvrir l’une des premières œuvres de Marguerite Yourcenar, intitulée Alexis ou le Traité du vain combat et publiée en 1929. Un texte d’à peine cent pages, magnifique et indispensable, ni tout à fait romanesque (c’est la lettre de rupture d’un mari à son épouse) ni totalement autobiographique.
Dans ce livre, Yourcenar évoque le cheminement d’un homme qui mettra des années avant de prendre conscience qu’il est homosexuel puis d’assumer enfin son homosexualité. Entre-temps, il s’est marié et a eu un enfant de la femme qu’il choisit de quitter afin d’accomplir pleinement sa quête de sens(ualité). Jamais les mots homosexualité, inversion ou homosexuel ne sont prononcés. Tout est nuances et délicatesse. Conseiller ce petit livre octogénaire, écrit de surcroît dans une langue plus proche de la confession de Manon Lescaut que de celle des sorties du placard claironnées au XXIe siècle ? Que oui ! Parce que le style et l’expression de Yourcenar y sont d’une grande pureté malgré une langue très académique. Et aussi parce que le propos que tient le narrateur n’a rien perdu de sa brûlante actualité.
On trouvera ci-dessous un certain nombre de phrases illustrant le long et torturé cheminement de cet homme qui aura failli être broyé par la triple pression de la société, de la religion et du conformisme, avant que de pouvoir enfin mettre un nom sur ses « maux » et les « soigner » en reconnaissant qu’il n’est pas plus « malade » que le cheval qui galope ou que l’oiseau qui vole.
Quatre-vingt-deux ans plus tard, les affres de l’acceptation de soi, telles que décrites dans cette belle œuvre de Marguerite Yourcenar, n’ont pas perdu une ride. L’omniprésence de l’électronique n’y a rien changé. On comprendra en revanche, à la lecture des extraits ci-dessous, combien Internet pourra éviter bien des drames intérieurs, par le simple fait qu’il apporte illico toute l’information nécessaire à quiconque se pose des questions sur son orientation sexuelle.
La pagination fait référence à l’édition parue en 1982 chez Gallimard dans la collection La Pléiade (réimpression de 2008). La préface de Marguerite Yourcenar est celle de 1963.
J’ai choisi de livrer les citations ci-dessous sans les entrelarder de commentaires. La « narration » du livre étant quasi chronologique, elle correspond à la chronologie d’un cheminement personnel classique. Les deux derniers extraits, tirés de la préface de 1963, n’intéresseront peut-être que les êtres – comme disait Montherlant – férus d’histoire littéraire.
« Les gens qui parlent par ouï-dire se trompent presque toujours, parce qu’ils voient du dehors, et qu’ils voient grossièrement. Ils ne se figurent pas que des actes qu’ils jugent répréhensibles puissent être à la fois faciles et spontanés, comme le sont pourtant la plupart des actes humains. Ils accusent l’exemple, la contagion morale et reculent seulement la difficulté d’expliquer. Ils ne savent pas que la nature est plus diverse qu’on ne suppose ; ils ne veulent pas le savoir, car il leur est plus facile de s’indigner que de penser. Ils font l’éloge de la pureté ; ils ne savent pas combien la pureté peut contenir de trouble ; ils ignorent surtout la candeur de la faute. » (p. 23)
« Naturellement, je ne pouvais me juger que d’après les idées admises autour de moi : j’aurais trouvé plus abominable encore de ne pas avoir horreur de ma faute que de l’avoir commise ; je me condamnais donc sévèrement. Ce qui m’effrayait surtout, c’était d’avoir pu vivre ainsi, être heureux pendant plusieurs semaines, avant d’être frappé par l’idée du péché. » (p. 32)
« Je n’avais personne à qui demander un conseil. La première conséquence de penchants interdits est de nous murer en nous-mêmes : il faut se taire, ou n’en parler qu’à des complices. » (p. 35)
« J’avais lu, j’ignore dans quel livre, que certains troubles ne sont pas rares, à une époque déterminée de l’adolescence ; j’antidatais mes souvenirs pour me prouver qu’il s’agissait d’incidents très banals, limités à une période de la vie que j’avais dépassée. Je ne songeais même pas aux autres formes du bonheur : il me fallait choisir entre mes penchants, que je jugeais criminels, et une renonciation complète qui n’est peut-être pas humaine. Je choisis. Je me condamnai, à vingt ans, à l’absolue solitude des sens et du cœur. Ainsi commencèrent plusieurs années de luttes, d’obsessions, de sévérité. Il ne m’appartient pas de dire que mes efforts furent admirables ; on pourrait dire qu’ils furent insensés. En tout cas, c’est quelque chose que de les avoir faits ; ils me permettent aujourd’hui de m’accepter plus honorablement moi-même. » (p. 39)
« Plus ma conduite m’avait semblé répréhensible, plus je m’étais attaché aux idées morales rigoureuses qui condamnaient mes actes. » (p. 62)
« Sans doute, ceux auxquels je me comparais se fussent indignés d’un rapprochement semblable ; ils se croyaient normaux, peut-être parce que leurs vices étaient très ordinaires ; et cependant, pouvais-je les juger bien supérieurs à moi, dans leur recherche d’un plaisir qui n’aboutit qu’à soi-même, et qui, le plus souvent, ne souhaite pas l’enfant ? Je finissais par me dire que mon seul tort (mon seul malheur plutôt) était d’être, non certes pire que tous, mais seulement différent. Et même, bien des gens s’accommodent d’instincts pareils aux miens ; ce n’est pas si rare, ni surtout si étrange. Je m’en voulais d’avoir pris au tragique des préceptes que démentent tant d’exemples – et la morale humaine n’est qu’un grand compromis. » (p. 68)
« Seulement j’aime encore mieux la faute (si c’en est une) qu’un déni de soi si proche de la démence. La vie m’a fait ce que je suis, prisonnier (si l’on veut) d’instincts que je n’ai pas choisis, mais auxquels je me résigne, et cet acquiescement, je l’espère, à défaut du bonheur, me procurera la sérénité. » (p. 75)
« Pour ceux qui auraient oublié leur latin d’école, notons que le nom du principal personnage (et par conséquent le titre du livre) est emprunté à la deuxième Églogue de Virgile, Alexis, à laquelle, et pour les mêmes raisons, Gide prit le Corydon de son essai si controversé. Le sous-titre, d’autre part, Le Traité du vain combat, fait écho au Traité du vain désir, cette œuvre un peu pâle de la jeunesse d’André Gide. En dépit de ce rappel, l’influence de Gide fut faible sur Alexis : l’atmosphère quasi protestante et le souci de réexaminer un problème sensuel viennent d’ailleurs. Ce que j’y retrouve au contraire dans plus d’une page (et à l’excès peut-être), c’est l’influence de l’œuvre grave et pathétique de Rilke, qu’un hasard heureux m’avait fait connaître de bonne heure. » (Préface, p. 7)
« Des grands livres de Gide où le sujet qui m’occupe était enfin ouvertement traité, la plupart ne m’étaient encore connus que par ouï-dire ; leur effet sur Alexis tient bien moins à leur contenu qu’au bruit fait autour d’eux, à cette espèce de discussion publique s’organisant autour d’un problème jusque-là examiné en huis clos, et qui m’a certainement rendu plus facile d’aborder sans trop d’hésitation le même thème. C’est du point de vue formel surtout que la lecture des premiers livres de Gide m’avait été précieuse, en me prouvant qu’il était encore possible d’utiliser la forme purement classique du récit, qui autrement eût risqué peut-être de me sembler à la fois exquise et surannée, et en m’évitant de tomber dans le piège du roman proprement dit, dont la composition demande de son auteur une variété d’expérience humaine et littéraire qu’à cette époque je n’avais pas. » (Préface, p. 7)

Et puisque l’on parle d’homosexualité en littérature, je ne résiste pas à l’envie de relayer une info que m’a signalée ma grande copine Corinne. L’info en question a quarante-cinq ans d’âge, puisqu’elle date du 1er avril 1966. La deuxième livraison de La quinzaine littéraire chroniquait, sous la plume de Dominique Fernandez, la parution de trois ouvrages signés Julien Green. Aucun de ces deux écrivains n’était encore devenu académicien et Fernandez n’avait pas encore fait son coming out.
On trouvera, en pages 6 et 7 (ici ou ici, puis cliquer sur l’icône pour lire le magazine), un article intitulé « Comment on devient homosexuel » où Fernandez livre au lecteur, mais apparemment au premier degré et sans intention humoristique, l’ensemble des clichés – sociologiques, psychanalytiques, etc. – de son temps accréditant les hypothèses les plus farfelues et les plus fidèles au conformisme ambiant, quant à la genèse de l’homosexualité chez l’homme en général et chez Green en particulier.
On ne sait trop s’il faut en rire ou en pleurer. En tout cas, la revue de Maurice Nadeau publiait là un texte qui a valeur de document.
Références.
Marguerite Yourcenar, Alexis ou le Traité du vain combat, in Œuvres romanesques, Gallimard, coll. « La Pléiade », 1982 (pagination de 2008).
La Quinzaine littéraire, n° 2, 1er avril 1966, en ligne.
Philca / MensGo